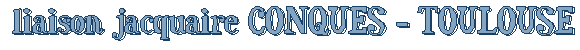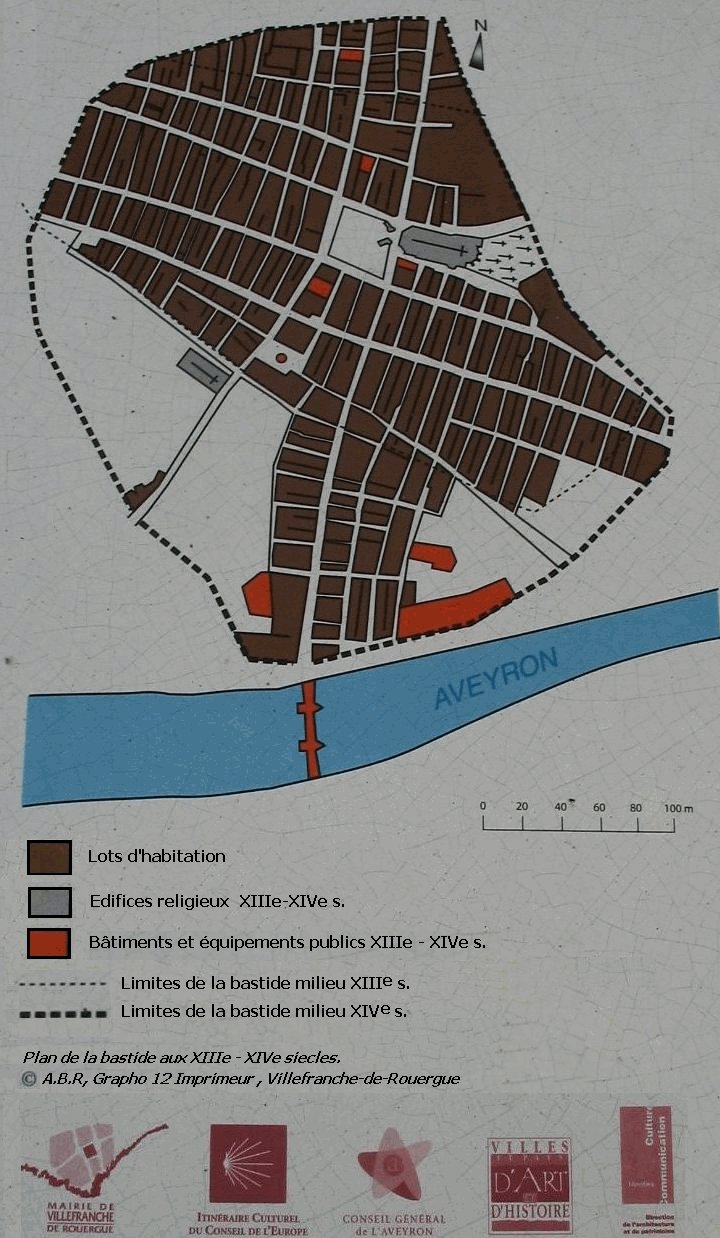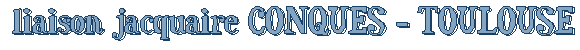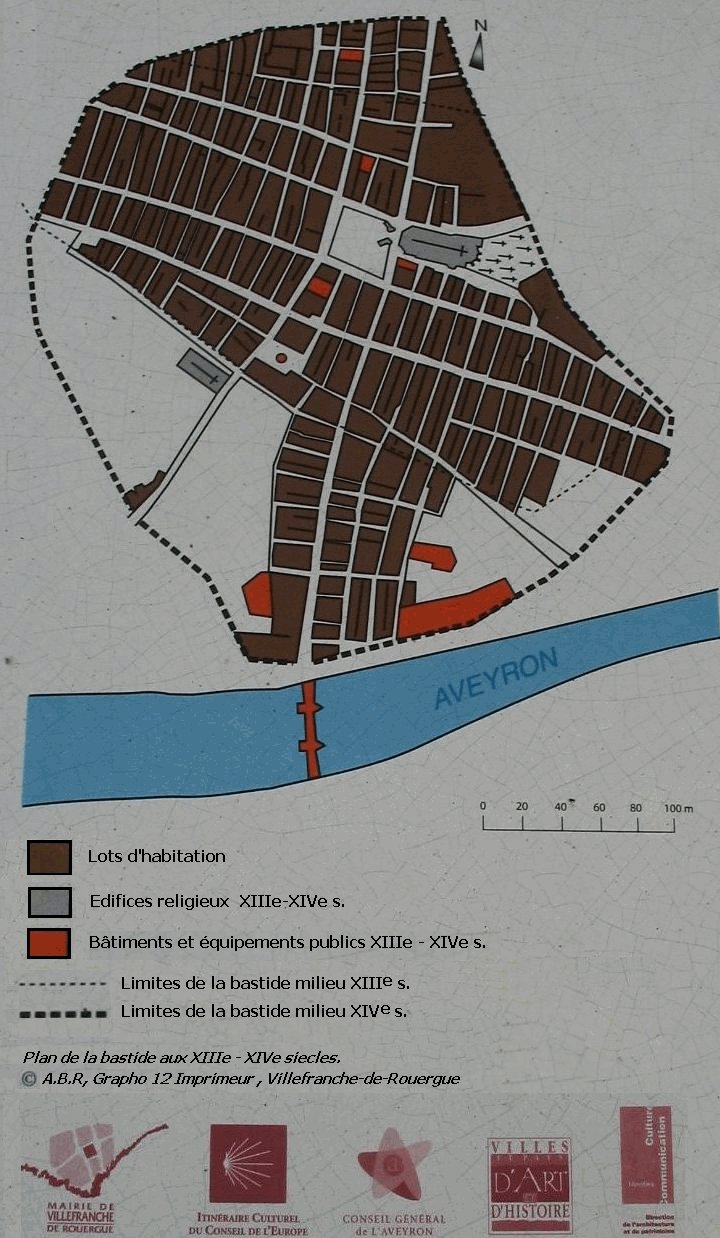L'installation des premiers habitants
La bastide, un vaste lotissement organisé autour d'une place et délimité par un réseau de rues se
coupant à angle droit , se compose de plusieurs centaines de parcelles. Un lot à bâtir (ayral) est
donné à chaque famille. Un jardin (casal) ou un champ (ortus) situé à l'extérieur de la ville, en
bordure de l'Aveyron , lui est également attribué afin de subvenir à ses besoins. Un délai de deux
ans est accordé aux nouveaux habitants afin de construire leur maison, pour laquelle ils devront
payer chaque année une taxe proportionnelle à la surface bâtie (fouage). Les plus ambitieux,
marchands et notables ; s'installent le long de la place du marché et des rues charretières.
L'évêque de Rodez, Vivian de Boyer, dépossédé de son bien et en désaccord avec l'administration
royale, excommunia les premiers habitants de la bastide.
Une amorce de gestion démocratique.
Dès 1256, les habitants disposent de libertés et d'avantages fiscaux (coutumes et franchises). Ils sont
représentés par quatre consuls désignés chaque année parmi les bourgeois de la ville.
Placés sous le contrôle d'officiers royaux, les consuls sont chargés de percevoir les taxes et impôts
, d'organiser les marchés et les foires, de bâtir les équipements urbains (pont, halle, fontaine
publique, hôpitaux, fours banaux ), d'entretenir la voirie et de défendre la ville..Comme de nombreuses
bastides, Villefranche est divisée fiscalement en quatre quartiers (gâches).
Un phénomène urbain remarquable. L'urbanisme
Les bastides ont été construites aux XIIIè et XIVème siècles (entre 1229 et 1373) , entre le Bordelais
et les Pyrénées , le Rouergue et les portes de la Méditerranée, pendant une période de paix relative
comprise entre la fin de la seconde croisade contre les albigeois et le début de la guerre de cent ans.
Fondés par les seigneurs laïcs (rois de France, rois d'Angleterre, comtes, châtelains) ou des responsables
religieux ( évêques, abbés), ces villages neufs et ces villes neuves qui constituent un réseau urbain ont
permis de regrouper la population des campagnes , de mettre en valeur l'espace agricole et de créer
des ressources économiques.
Ce phénomène urbanistique est lié à un important essor démographique. Aux XIIè et XIIIè siècles en effet,
un réchauffement climatique et l'amélioration des techniques agricoles permettent à la population
européenne de se développer de manière spectaculaire. Dans la France méridionale ; cette vitalité
donne lieu à la création de plus de 300 bastides. Cependant , le phénomène n'est pas isolé. Il prolonge
un premier mouvement de création de villages et de bourgs (sacarias, sauvetés, bourgs castraux) impulsé
par l'église et l'aristocratie militaire pendant l'époque romane.
Collégiale Notre-Dame
A l'entrée de la collégiale, un panneau nous raconte rapidement l'histoire de la collégiale.
Laissons nous tenter de vous le présenter.
|